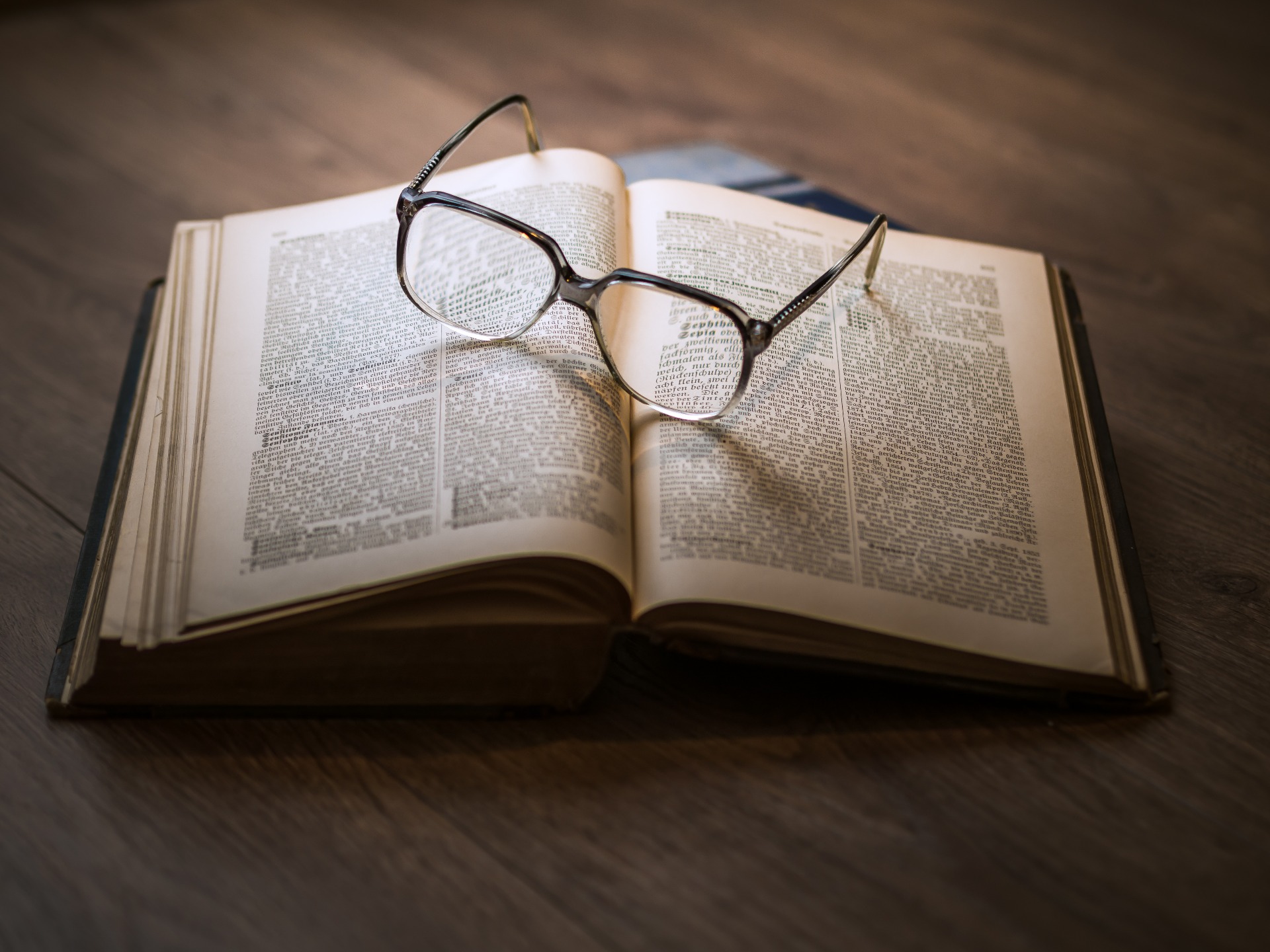L'impact et les conséquences de leur combat
Le développement moral et de nouvelles mentalités
Alors que les femmes se battent afin d'obtenir une place au sein de tout cette intellectualité masculine, certains de ces hommes, partisans de l'égalité, les soutiennent. Tous spectateurs impuissants des injustices subies par les femmes auxquelles s'ajoute leur persévérance sans précédent, certains esprits jusqu'alors figés dans leur mutisme émergent au profit des défenseurs de droits féminins.
François Poullain de La Barre,
écrivain,
philosophe et féministe a rédigé de nombreux textes sur les préjugés sexistes
des femmes au XVIIème siècle. Son idée principale est que « l'esprit n'a pas de
sexe ». « Nous sommes remplis de préjugés [ dit-il]. De tous les préjugés, on
en n'a point remarqué de plus propre que celui qu'on a communément sur
l'inégalité des sexes ». François Poullain se voit alors comme l'un des
précurseurs des grands mouvements féministes du XIX et XXème siècles en
influençant de nombreux esprits féminins au combat nécessaire pour leurs justes
droits, mais aussi pour leur écriture.
De son côté, après la mort de son père et jusqu'à ses 9 ans, Nicolas de Condorcet fut élevé et apprêté à la manière d'une fille par sa mère. C'est à l'âge de 16 ans qu'il est remarqué de D'Alembert et soutient sa thèse mathématique. Condorcet militant pour les droits des femmes s'affiche comme un fort soutien du mouvement pré-féministe en admettant, comme vu précédemment, dans son œuvre Sur l'admission des femmes au droit de cité « que la loi ne devrait exclure les femmes d'aucune place. [...] Songez qu'il s'agit des droits de la moitié du genre humain » Son ouverture d'esprit face aux injustices féminines l'a dès lors placé au cœur du combat féminin. Toutefois, Condorcet est bien entendu loin d'être l'unique homme contre l'exclusion des femmes dans cette société trop patriarcale.
Choderlos de Laclos
Un an après la publication de son plus grand succès, Les liaisons dangereuses, Choderlos de Laclos, officier militaire et grand écrivain des Lumières, publie Des femmes et de leur éducation, un texte inachevé mais repris et complété en 1908 et 2018. Laclos se livre dans son écrit à une réédification présumée de l'histoire de l'humanité afin d'éclairer sur les inégalités entre hommes et femmes. Il établit donc chronologiquement une forme d'argumentation sur ce qui a bien pu se passer à travers les siècles pour arriver à la situation chaotique actuelle.
Il s'exprime premièrement en disant que « Quand on parcourt l'histoire des différents peuples, qu'on examine les lois et les usages promulgués et établis à l'égard des femmes, on est tenté de croire qu'elles n'ont que cédé, et non pas consenti au contrat social, qu'elles ont été primitivement subjuguées, et que l'homme a sur elles un droit de conquête dont il use rigoureusement ». Ainsi, Laclos propose l'hypothèse que depuis toujours, les femmes sont restées tributaires des hommes qui exerçaient sur elles un « droit de conquête » comme s'il s'agissait d'un être futile tel qu'un esclave. Il ajoute que dès lors que les hommes se rendirent compte de l'importance des femmes dans leur vie, « ils s'occupèrent donc à les contraindre, ou les persuader, de s'unir à eux. Soit force, soit persuasion, la première qui céda, forgea les chaînes de tout son sexe. » Laclos continue sa critique de la société avec une métaphore filée remarquable en filigrane tout le long de son écrit. Il compare de façon métaphorique l'égalité et le partage, à la notion de fruits et de culture. L'auteur décrit que « dans les premiers temps, il n'y eut aucune propriété exclusive ; on partageait également les fruits d'un champ cultivé en commun » ainsi qu' « on en usait de même du gibier tué dans une chasse générale » et que « les femmes mêmes suivirent cette loi ; toutes étaient à tous ». Il cherche à démontrer une entente « générale » entre hommes et femmes sous ce mode de vie où le partage de chaque détail, tâches ou dur labeur était égalitaire et sans préjugé avec un aspect plus que positif. Toutefois, la suite de l'essai se voit moins avantageuse et plus prosaïque lorsqu'il poursuit en disant que « dans cette communauté de travaux et de fruits, il est aisé de pressentir que le partage ne dut pas être longtemps égal » et ramène à la réalité de la « loi du plus fort » où les « femmes [ ... ]étaient plus faibles » et étaient « assujetties aux travaux les plus pénibles, et en recueillirent le moins de fruit ». Laclos poursuit en admettant que « les hommes étendirent bientôt jusqu'à elles cette même idée de propriété qui venait de les frapper ». Bientôt, l'auteur conclut sa reconstruction historique hypothétique par des détails relevant de la réalité de son temps, dictant que désormais les femmes « leur appartenaient ». Leur condition de « femme objet » d'utilité minine outre les travaux domestiques est vivement critiquée par Laclos qui enchaîna en ajoutant que « Les femmes manquant de forces ne purent se défendre et conserver leur existence civile » et donc aujourd'hui soumises à une absence totale de droits. « Les compagnes de nom [ dit-il ] devinrent bientôt esclaves de fait, et esclaves malheureuses ». Ainsi, « leur sort ne dut guère être meilleur que celui des Noirs des colonies ». Grâce à cette comparaison entre les femmes et les esclaves, Laclos tend à provoquer la bonne morale du lecteur, alors que la question des esclaves dans la société française demeurait un sujet sensible jusqu'à son abolition. Une atmosphère est rapidement ressentie à travers les lignes de Laclos par l'utilisation d'un vocabulaire orienté vers la servitude imposée. En effet, tout le long de son écrit l'auteur utilise l'image des « chaînes » ; « conquête » ; « de travaux pénibles » ou même des « Noirs des colonies ».
Ainsi,
Laclos s'impose ici comme
un délivreur de pensées féministes, incompréhensif avec les valeurs morales des
hommes de son temps, ne voyant pas l'injustice qu'ils imposaient à leurs
compagnes.
De son côté, Voltaire, un grand écrivain, philosophe des Lumières et partisan de la justice sociale, politique et religieuse, publia en 1768 son œuvre intitulée Mélanges, Pamphlets et œuvres polémiques sur un entretien avec l'homme diplomate et habile qu'était l'abbé de Chateauneuf. Dans cet écrit, Voltaire discute la condition féminine et leurs injustices, après avoir entretenu une relation durant dix années avec Mme du Châtelet, renommée pour être une des femmes les plus érudites et importantes des Lumières.
Voltaire commence par évoquer la situation initiale à son écrit, soit une femme qui « passa quarante années dans cette dissipation et dans ce cercle d'amusements qui occupent sérieusement les femmes ; n'ayant jamais rien lu que des lettres qu'on lui écrivait, n'ayant jamais mis dans sa tête que les nouvelles du jour, les ridicules de son prochain et les intérêts de son cœur ». Cependant, dès lors que cette femme « se vit à cet âge où l'on dit que les belles femmes qui ont de l'esprit passent d'un trône à l'autre, elle voulut lire ». Ainsi, après s'être rendue compte de sa minorité, elle décida de reprendre en main son esprit pervertit par les préjugés de son temps. Voltaire continue son récit en montrant son institution. Il dit qu'« on lui fit lire du Montaigne » et qu'elle fut « charmée d'un homme [...] qui doutait de tout » puis par la suite, on lui donna « les grands hommes de Plutarque » et qu'elle se « demanda pourquoi il n'avait pas écrit l'histoire des grandes femmes ». Elle se mit dès ce jour à réaliser sa position de « sexe inférieur » et sa colère atteignit son apogée lors d'une conversation banale avec l'abbé Châteauneuf et qu'elle découvrit un recueil dictant « Femmes, soyez soumises à vos maris » de saint Paul. La maréchale de Grancey, demeurant incompréhensive avec ces dires, poursuivit sa conversation avec l'abbé, en qualifiant l'auteur saint Paul comme étant « très impoli ». Elle ajoute par la plume de Voltaire : « si j'avais été la femme d'un pareil homme, je lui aurais fait voir du pays. Soyez soumises à vos maris ! Encore s'il s'était contenté de dire : Soyez douces, complaisantes, attentives, économes, je dirais : Voilà un homme qui sait vivre ; et pourquoi soumises, s'il vous plaît ? ». Son indignation se démarque finalement quelques lignes plus loin lors de sa longue tirade : « Sommes-nous donc des esclaves ? N'est-ce pas assez qu'un homme, après m'avoir épousée, ait le droit de me donner une maladie de neuf mois, qui quelquefois est mortelle ? N'est-ce pas assez que je mette au jour avec de très grandes douleurs un enfant qui pourra me plaider quand il sera majeur ? Ne suffit-il pas que je sois sujette tous les mois à des incommodités très désagréables pour une femme de qualité, et que, pour comble, la suppression d'une de ces douze maladies par an soit capable de me donner la mort sans qu'on vienne me dire encore : Obéissez ? Certainement la nature ne l'a pas dit ; elle nous a fait des organes différents de ceux des hommes ; mais en nous rendant nécessaires les uns aux autres, elle n'a pas prétendu que l'union formât un esclavage. » La maréchale de Grancey pose sous forme d'une succession de questions rhétoriques son écoeurement face à la misogynie de certains. Elle qui n'a connu que la bienveillance et la compréhension de son époux, refuse d'imaginer que de tels propos soient possibles. Elle conclut finalement en citant Molière : « Du côté de la barbe est la toute-puissante », et y ajoute : « Mais voilà une plaisante raison pour que j'aie un maître! Quoi! Parce qu'un homme a le menton couvert d'un vilain poil rude, qu'il est obligé de tondre de fort près, et que mon menton est né rasé, il faudra que je lui obéisse très humblement ? Je sais bien qu'en général les hommes ont les muscles plus forts que les nôtres, et qu'ils peuvent donner un coup de poing mieux appliqué : j'ai peur que ce ne soit là l'origine de leur supériorité ». Les paroles de la maréchale Grancey, d'une âpreté sans précédent, témoignant donc d'un dégoût envers cet aspect du genre masculin de son temps, qu'elle ignorait.
En somme, ces auteurs éclairés et compréhensifs témoignent d'une nouvelle morale, incluant la mesure de justice pour les personnalités féminines, rêvant d'émancipation et de considération. Grâce à leur notoriété, ces grands auteurs et philosophes développèrent l'idée d'égalité entre les sexes bien avant l'arrivée des grands mouvement féministes des XIXème et XXème siècles, permettant donc à certaines femmes d'être enfin écoutées et admirées à leur juste valeur.
En définitive
En somme, ces auteurs éclairés et compréhensifs témoignent d'une nouvelle morale, incluant la mesure de justice pour les personnalités féminines, rêvant d'émancipation et de considération. Grâce à leur notoriété, ces grands auteurs et philosophes développèrent l'idée d'égalité entre les sexes bien avant l'arrivée des grands mouvement féministes des XIXème et XXème siècles, permettant donc à certaines femmes d'être enfin écoutées et admirées à leur juste valeur.