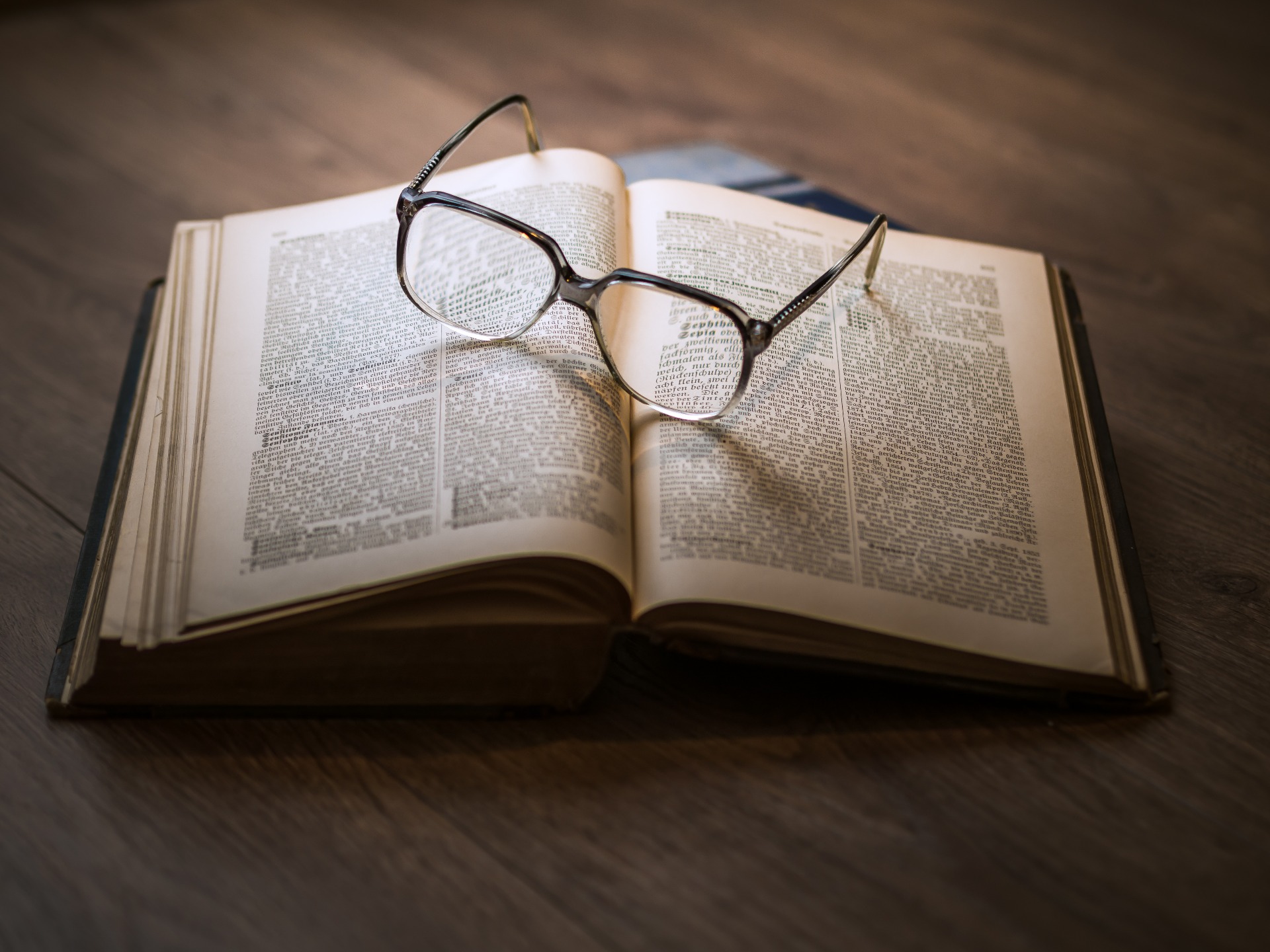L'accès vers de nouveaux droits et une nouvelle condition
Des aménagements bénéfiques
En outre, de nouveaux lieux érudits de la haute société font leur apparition : Les salons. Ici, on s'adonne à l'art de la conversation. Ces salons sont tenus principalement par des femmes, souvent issues de la bourgeoisie et jouissant de grandes connaissances. Pour que ces derniers connaissent du succès, la maîtresse des lieux doit posséder les services d'un philosophe, qui va lancer les débats sur des faits actuels. Tenir un lieu de ce genre est une des activités les plus réputées de cette époque, s'ajoutant au fait que la qualité des invités témoigne du pouvoir d'attraction du salon, et ainsi de sa réputation. Ils sont des lieux de diffusion de la culture, témoignant de la grande érudition de nombreux esprits du siècle. Cependant, même si les femmes sont dites comme les maîtresses de ces lieux réputés, il ne s'agit seulement que d'une apparence. En effet, malgré l'apparence des salons présidés par les femmes, ils sont chacun majoritairement peuplés d'hommes. Qu'il s'agisse de Condorcet, Lavoisier, Montesquieu, Voltaire, Diderot, d'Alembert, ils ne sont évidement qu'une infime minorité de la population masculine. Même si les femmes n'exerce qu'en présidence des salons, elles sont d'une importance non négligeable dans l'éducation de leurs filles.
Mme de Mimeront
En 1779, Mme de Mimeront dans son Traité de l'éducation des femmes, et cours complet d'instruction explique à ses lecteurs les raisons de l'importance des mères dans l'éducation des filles. Durant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, les pédagogues déterminent, encouragent et inspirent les femmes à jouer un rôle important dans cette éducation.
Certains philosophes sont contre l'éducation des jeunes filles dans les couvents, un lieu pourtant majeur dans leur éducation de futures femmes de la haute société. Pour la société et notamment les hommes de lettres des Lumières, l'éducation dans les couvents est considéré comme « l'antithèse de l'idéal maternel ».
Mme de Graffigny
Une femme philosophe, Mme de Graffigny (1695-1758), n'idéalise pas la maternité et présente les religieuses comme des agents de l'obscurantisme. Dans un de ses ouvrages, elle écrit que « Du moment que les filles commencent à être capables de recevoir des instructions, on les enferme dans une maison religieuse, pour leur apprendre à vivre dans le monde. Que l'on confie le soin d'éclairer leur esprit à des personnes auxquelles on ferait peut-être un crime d'en avoir, et qui sont incapables de leur former le cœur, qu'elles ne connaissent pas.»
Cependant, l'échange de lettres entre mères et filles amène à construire les femmes qu'elles demeureront à l'avenir, dans un idéal de connaissance et d'intellectualité. Ces correspondances contribuent à atténuer la douleur de la séparation entre mères et filles, tout en permettant aux mère de constater les progrès de leurs enfants. Grâce aux lettres, elles apprennent l'art de la correspondance avec pour partenaire d'entraînement, leur mère. Dans les couvents les plus prestigieux, les religieuses ne sont pas des enseignantes, c'est à la gouvernante de compléter l'éducation des demoiselles, avec de la musique, de la danse, de l'écriture, de la grammaire, et de l'histoire naturelle. Dans son œuvre le Discours sur la suppression des couvents de religieuses, et sur l'éducation publique des femmes, datant de 1791, Mme de Genlis (1746-1830) explique ces faits.
Montesquieu, Diderot & Laclos
- L'un des premiers écrivains proposant un changement dans l'éducation des jeunes femmes est Montesquieu. Il met en relief le modèle pédagogique de l'Antiquité et observe en conclusion les différences avec l'éducation actuelle. Il ne reconnaît pas la séparation entre la haute société et le modèle religieux et dicte qu' « Aujourd'hui nous recevons trois éducations différentes et contraires : celles de nos pères, celles de nos maîtres, celle du monde. Ce qu'on nous dit dans la dernière renverse toutes les idées des premières. Cela vient, en quelques parties, du contraste qu'il y a parmi nous entre les engagements de la religion et ceux du monde ; chose que les anciens ne connaissent pas. »
- Quant à Diderot et Laclos, tout deux réfléchissent à la meilleure éducation qui pourrait être enseignée aux futures femmes en mettant en relief l'éducation traditionnelle ainsi que ses limites pédagogiques. Diderot observe que l'éducation des filles est trompeuse, étant fondée sur la recherche des plaisir mondains, il constate que « Le soin principal est de prévenir l'ennui, de multiplier les amusements, d'étendre les jouissances. A cette époque, les femmes sont recherchées avec empressement, et pour les qualités aimables qu'elles tiennent de la nature, et pour celles qu'elles ont reçues de l'éducation ». ». Les Liaisons dangereuses de Laclos est une constatation de l'asservissement des femmes, à travers le personnage contestataire de la Marquise de Merteuil, en retraçant sa vie mais aussi son parcours dans la célèbre lettre 81, qui reconnaît que la société les voit comme inférieures. Or pour elle, une femme doit conquérir son pouvoir sur les hommes
La Marquise de Merteuil au Vicomte de Valmont
« Que vos craintes me causent de pitié ! Combien elles me prouvent ma supériorité sur vous ! & vous voulez m'enseigner, me conduire ! Ah ! mon pauvre Valmont, quelle distance il y a encore de vous à moi ! Non, tout l'orgueil de votre sexe ne suffirait pas pour remplir l'intervalle qui nous sépare. Parce que vous ne pourriez exécuter mes projets, vous les jugez impossibles ! Etre orgueilleux & faible, il te sied bien de vouloir calculer mes moyens & juger de mes ressources ! Au vrai, Vicomte, vos conseils m'ont donné de l'humeur, & je ne puis vous le cacher. Que pour masquer votre incroyable gaucherie auprès de votre Présidente, vous m'étaliez comme un triomphe d'avoir déconcerté un moment cette femme timide & qui vous aime, j'y consens ; d'en avoir obtenu un regard, un seul regard, je souris & vous le passe. Que sentant, malgré vous, le peu de valeur de votre conduite, vous espériez la dérober à mon attention, en me flattant de l'effort sublime de rapprocher deux enfants qui, tous deux, brûlent de se voir, & qui, soit dit en passant, doivent à moi seule l'ardeur de ce désir ; je le veux bien encore. Qu'enfin vous vous autorisiez de ces actions d'éclat, pour me dire d'un ton doctoral, qu'il vaut mieux employer son temps à exécuter ses projets qu'à les raconter ; cette vanité ne me nuit pas, & je la pardonne. Mais que vous puissiez croire que j'ai besoin de votre prudence, que je m'égarerais en ne déférant pas à vos avis, que je dois leur sacrifier un plaisir, une fantaisie ! en vérité, Vicomte, c'est aussi vous trop enorgueillir de la confiance que je veux bien avoir en vous ![...] A ces précautions que j'appelle fondamentales, s'en joignent mille autres, ou locales, ou d'occasion, que la réflexion & l'habitude font trouver au besoin ; dont le détail serait minutieux, mais dont la pratique est importante, & qu'il faut vous donner la peine de recueillir dans l'ensemble de ma conduite, si vous voulez parvenir à les connaître. Mais de prétendre que je me donne tant de soins pour n'en pas retirer de fruits ; qu'après m'être autant élevée au-dessus des autres femmes par mes travaux pénibles, je consente à ramper comme elles dans ma marche, entre l'imprudence & la timidité ; que surtout je puisse redouter un homme au point de ne plus voir mon salut que dans la fuite ? Non, Vicomte, jamais. Il faut vaincre ou périr. Quant à Prévan, je veux l'avoir, & je l'aurai ; il veut le dire, & il ne le dira pas : en deux mots, voilà notre roman. Adieu.
De ... ce 20 septembre 17... »
En définitive, dans Des femmes et de leur éducation, Laclos finit par avouer qu'ils auraient pu changer ces conditions d'éducation, à travers une révolution en dictant « Ne vous laissez abuser par de trompeuses promesses, n'attendez point les recours des hommes auteurs de vos maux : ils n'ont ni la volonté ni la puissance de les finir, et comment pourraient-ils vouloir former des femmes devant lesquelles ils seraient forcés de rougir ? Apprenez qu'on ne sort de l'esclavage que par une grande révolution.»
- Cette affiche illustre des femmes lors d'un débat dans un club politique. La femme au centre de l'œuvre est sur l'estrade, et lance donc les débats et sujets discutés. Les femmes autours d'elle contestent ou acquiescent ses dires. Elles bénéficient donc de leur liberté d'opinion en revendiquant leurs pensées et leurs convictions. Le sujet probablement discuté devrait être la révolution de 1848 ou l'arrivée de la II ème république.