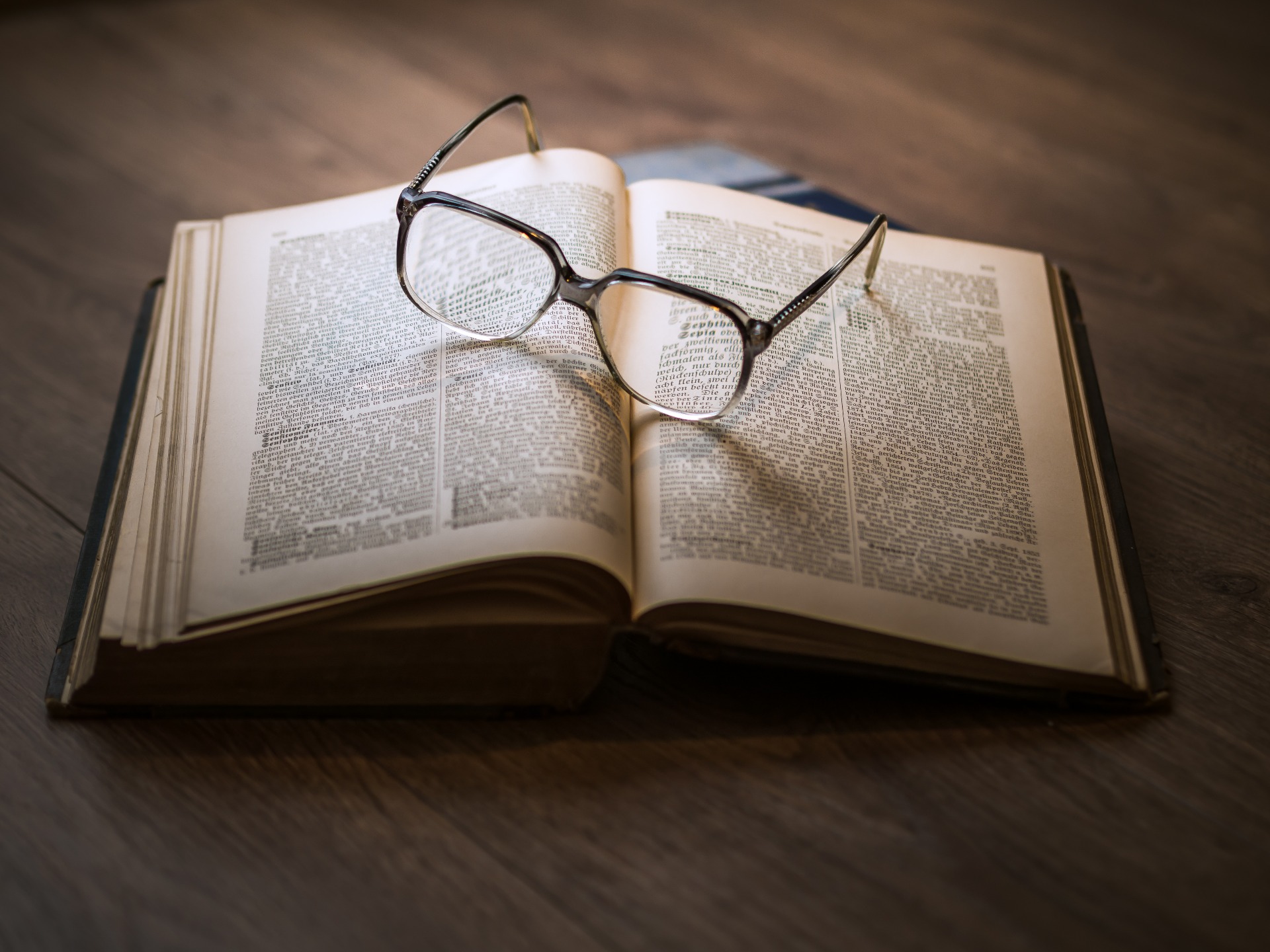L'impact et les conséquences de leur combat
De nouvelles perspectives féminines
Alors que la censure concernait principalement en France les auteurs critiquant le gouvernement ou la politique, une nouvelle forme de prohibition littéraire se voit apparaître au cœur même du siècle des Lumières. Victimes de préjugés misogynes infondés et de critiques violentes inacceptables, certaines femmes érudites du siècle éveillé préféraient s'adonner à une écriture anonyme plutôt que de subir les sévices verbaux et moraux infligés par des hommes ou même des femmes réfractaires à l'écriture féminine. Une forme d'auto-censure par la publication d'œuvres anonymes, se développe peu à peu, se voyant comme un moyen pour les femmes de publier une œuvre sans subir de préjugés et ainsi voir la réelle valeur de leur travail.
Madelaine de Scudéry
une
jeune femme du XVIIème et XVIIIème siècle, passionnée d'écriture, dit qu'
« écrire, c'est perdre la moitié de sa noblesse » pour une femme.
En effet, par l'écriture, celles-ci renonçaient généralement à une vie familiale puisqu'elles se voyaient exclues par la société n'étant pas favorables aux pratiques d'écriture féminine. Madelaine mènera une longue vie en faveur de l'écriture romanesque, puisqu'elle publiera de nombreuses œuvres, dont Clélie, histoire romaine, considéré comme le plus long roman de l'écriture française. Cependant, au début de sa carrière, elle publia ses premières œuvres sous le nom de son frère Georges, qui accepta sans hésitation de soutenir l'écriture de sa sœur craignant les critiques des esprits renfermés. Madelaine publia notamment Ibrahim ou l'Illustre Bassa, Artamène ou le Grand Cyrus, Almahide ou l'esclave reine, Mathilde d'Aguilar, histoire espagnole et son plus grand succès Clélie, histoire romaine, sous le nom de Georges.
Au XVIIIème siècle, l'écriture et la publication sous un nom d'emprunt ou sous anonymat se voyait très populaire, puisqu'elle permettait aux femmes désirant publier leurs œuvres, de réaliser leur rêve sans craindre les critiques ou préjugés.
Le combat des femmes des Lumières implique aussi la question des droits et d'une loi dans leur intérêt, demeurant toujours inexistante au XVIII ème siècle.
Nicolas de Condorcet
En Juillet 1790, Nicolas de Condorcet, grand représentant des Lumières, homme politique et mathématicien, publia son traité Sur l'admission des femmes au droit de cité. Consterné par l'absence de droits au profit des femmes dans une société en constante évolution dans tous les domaines, Condorcet émet une critique violente et satirique de la population masculine.

« L'habitude ; [ dit-il ] peut familiariser les hommes avec la violation de leurs droits naturels, au point que parmi ceux qui les ont perdus personne ne songe à les réclamer, ne croie avoir éprouvé une injustice.» Condorcet admet donc que la normalisation de cette injustice traduit l'abandon de toute contestation féminine. Il ajoute que « les droits des hommes résultent uniquement de ce qu'ils sont des êtres sensibles, susceptibles d'acquérir des idées morales, et de raisonner sur ces idées ; ainsi les femmes ayant ces mêmes qualités, ont nécessairement des droits égaux. Ou aucun individu de l'espèce humaine n'a de véritables droits, ou tous ont les mêmes ; et celui qui vote contre le droit d'un autre, quel que soit sa religion, sa couleur ou son sexe, a dès-lors abjuré les siens.» De ce fait, chaque individu jouissant de droits justes, mais proclamant l'interdiction au sexe opposé d'en bénéficier, ne respecte absolument pas le principe fondamental de la justice et des droits. Condorcet réprimande ensuite le comportement systématique des hommes de son temps de façon très satirique en ajoutant « Pourquoi des êtres exposés à des grossesses, et à des indispositions passagères, ne pourraient-ils exercer des droits dont on n'a jamais imaginé de priver les gens qui ont la goutte tous les hivers, et qui s'enrhument aisément ». Ainsi, l'auteur vient normaliser ce que chaque homme misogyne et apathique de son temps considérait comme le « devoir d'une femme », en le mettant ironiquement en parallèle avec un simple rhume. Il viendra même à comparer le comportement des époux et compagnons, à celui de « tyrans » ne priant que par la « servitude » de leur épouse. Condorcet continue sa critique de la société patriarcale qui place les hommes bien au-dessus des femmes, en disant « dira-t-on qu'il y ait dans l'esprit ou dans le cœur des femmes quelques qualités qui doivent les exclure de la jouissance de leurs droits naturels ? », et ainsi par cette question rhétorique, cherche à indigner le lecteur en appelant à sa morale, de l'injustice continuelle endurée par les femmes.
L'auteur vient insister sur l'importance féminine dans la vie politique et la société en ajoutant : « Les droits des citoyens n'auraient-ils pas été mieux défendus en France aux États de 1614 par la fille adoptive de Montaigne que par le conseiller Courtin, qui croyait aux sortilèges et aux vertus occultes ? La princesse des Ursins ne valait-elle pas un peu mieux que Chamillard ? Croit-on que la marquise du Châtelet n'eût pas fait une dépêche aussi bien que M. Rouillé ? Madame de Lambert aurait-elle fait des lois aussi absurdes et aussi barbares que celles du garde des sceaux d'Armenonville contre les protestants, les voleurs domestiques, les contrebandiers et les nègres ? », et ainsi, en valorisant les travaux enfouis sous les renommées masculines, de femmes portant un grand intérêt dans l'histoire. Il ajoute ensuite, qu'« En jetant les yeux sur la liste de ceux qui les ont gouvernés, les hommes n'ont pas le droit d'être si fiers. »,
Puis il défend leur rôle bien trop stéréotypé et source de prétexte afin d'éloigner les volontaires d'une vie politique et sociale en ajoutant qu'« Il est naturel que la femme allaite ses enfants, qu'elle soigne leurs premières années ; attachée à sa maison par ces soins, plus faible que l'homme il est naturel encore qu'elle mène une vie plus retirée, plus domestique. [...] Ce peut être un motif de ne pas les préférer dans les élections, mais ce ne peut être le fondement d'une exclusion légale. » Enfin, il conclut en revalorisant une seconde fois les travaux domestiques féminins en disant que « Les femmes sont supérieures aux hommes dans les vertus douces et domestiques » mais enchérit sur une autre critique en rappelant qu' « elles savent, comme les hommes, aimer la liberté, quoiqu'elles n'en partagent point tous les avantages » et qu'« elles ne sont pas conduites [...] par la raison des hommes, mais elles le sont par la leur. ».
Ainsi,
Ainsi, dans ce traité,
Nicolas de Condorcet développe l'idée d'une absence de droit de cité, ou de
droit de citoyenneté au profit de la population féminine, bien que d'un point
de vue physiologique ou naturel, leur égalité face aux hommes se voie
incontestable. Cependant, son écrit témoigne également d'un manque indéniable
de droits dans la vie féminine, prouvant donc leur exclusion au sein de la vie
politique, critiquée par la suite dans la Déclaration
des Droits de la Femme et de la Citoyenne, par Olympe de Gouges. Les droits
des femmes demeurent fortement restreints, et majoritairement attribués à leur
vie et tâches domestiques, ne profitant qu'aux hommes, satisfaits de ce mode de
fonctionnement.
Après de nombreuses contestations à la fois féminines mais aussi masculines, sur ces disparités juridiques éloignant les femmes de toute vie politique, une loi est votée le 20 septembre 1792.
Bien qu'elle soit abolie pendant la restauration de 1816, la loi du Divorce par consentement mutuel est une œuvre pionnière de la volonté d'égalité de droits entre les sexes tout en dédramatisant le divorce, jusqu'alors vu comme un péché effroyable par l'Eglise et la majorité du peuple français. Cette loi très importante dans l'histoire du féminisme français, symbolisa l'arrivée encore timide de droits juridiques incluant les femmes et leur libération progressive de leur emprisonnement sous la tutelle des hommes, et de leur époux.